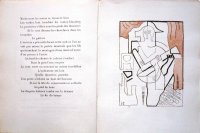S’échelonnant sur une bonne partie du XXe siècle, l’histoire du Fonds Reverdy illustre d’abord l’incroyable flair de Jacques Doucet. Dès 1916, celui-ci sent obscurément que Reverdy, qui n’a alors publié qu’un seul titre, participe du filon le plus pur de ce qui se crée alors aux confins de la poésie et de l’art. Cet homme qui manie si malaisément la plume quand il veut s’expliquer sur ses goûts reconnaît tout de suite en Reverdy un créateur majeur de l’époque, prenant en cela une belle avance sur la critique et sur l’Université. Dans son vaste dessein d’accumuler pour les chercheurs de l’avenir les éléments essentiels à la compréhension en profondeur d’une époque, il va demander à Reverdy de lui fournir les plus beaux tirages de ses livres, de lui réserver ses manuscrits de travail, de rédiger à son intention des pages de réflexion sur l’état de la littérature et de l’art.
La seconde grande phase d’enrichissements sera déclenchée par la préparation de la remarquable exposition À la rencontre de Reverdy et ses amis, mise sur pied notamment grâce à Nicole Worms de Romilly, qui se tiendra en 1970 à la Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence. Demeurée dans la solitude de Solesmes depuis la mort de son mari survenue dix ans plus tôt, Mme Reverdy se découvre alors en conjonction pleinement amicale avec Marguerite et Aimé Maeght. Le désintéressement absolu d’Henriette Reverdy, qui non seulement fait don de tous ses droits sur l’œuvre de son mari à la Fondation Maeght — la gestion étant confiée à un Comité Reverdy créé à cet effet — mais encore se désiste d’archives inestimables, trouve son répondant dans la générosité de Marguerite et Aimé Maeght qui vont offrir à la Bibliothèque un grand nombre de manuscrits et de livres restés dans cette modeste maison de Solesmes où Reverdy a vécu de 1926 jusqu’à sa mort en 1960.
Les dispositions de la donation consentie par Marguerite Maeght furent acceptées sans réserve le 1er juillet 1977— et avec la satisfaction qu’on imagine — par le Recteur Chancelier des Universités de Paris, Robert Mallet. Comme d’autres actes de donation, elles stipulaient que les manuscrits, livres, documents étaient « offerts à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, sous la garantie du Recteur Chancelier, pour rester à la disposition de toutes les Universités de Paris, sans pouvoir être divisés, ni affectés, totalement ou partiellement, à telle ou à telle Université en particulier ou à un autre établissement. » Occasion pour moi-même de souligner que cette indépendance statutaire de la Bibliothèque par rapport à tout établissement — qu’il s’agisse d’une autre bibliothèque, d’un organisme de recherche ou d’une université particulière — s’est révélée pour les donateurs la garantie que leurs dons trouveraient à la Bibliothèque Doucet les meilleures conditions de conservation et de contrôle des consultations, dans le respect des prérogatives de la propriété littéraire à laquelle sont légitimement attachés certains héritiers. Ce régime, dont la remise en cause risquerait de susciter tarissement des dons et contentieux, est assez exceptionnel dans une collection publique. Il a été et reste un puissant encouragement aux libéralités des particuliers.
Cette marée d’enrichissements ne se serait pas réalisée si notre cher François Chapon n’avait alors dirigé la bibliothèque qui porte toujours son empreinte. L’estime que sa science de grand spécialiste du livre et du manuscrit modernes ainsi que sa connaissance vivante de la littérature et de l’art contemporains lui valent depuis longtemps auprès de Marguerite et Aimé Maeght, ne peut alors que se rencontrer avec la fidélité fervente que lui-même porte au souvenir de Pierre Reverdy, dont il a été l’un des plus proches amis durant les dernières années de sa vie, et cette fidélité à l’homme s’accompagne d’une connaissance profonde et sensible de l’œuvre. Classés soigneusement sous sa direction après que j’en eus fait un inventaire provisoire à la demande de Mme Maeght, ces nouveaux apports vont en quelques années augmenter considérablement le Fonds Reverdy rassemblé par Jacques Doucet. S’y ajouteront d’autres dons ainsi que des acquisitions selon la politique d’achat que Mme Sabine Coron perpétue à la Bibliothèque Doucet avec le discernement et le dévouement entier qui la caractérisent.
Puisque les documents et les livres exposés m’y invitent , je reviens rapidement sur les étapes qui ont rythmé les rapports de Doucet et de Reverdy. Sur ce sujet rien moins qu’anecdotique, je ne peux que renvoyer au récit savant et discrètement vibrant que François Chapon, justement, en a fait dans un livre qui, paru en 1984, a fait l’objet d’une nouvelle édition chez Fayard en 2006 sous le titre C’était Jacques Doucet. On reste étonné ou émerveillé qu’une relation assidue, amorcée par le libraire Camille Bloch, s’établisse en octobre 1916 entre Doucet et Reverdy, qui n’a pas encore publié sa Lucarne ovale. La rencontre se produit quelques mois après la mise en chantier de la bibliothèque (début 1916). Voici qu’avec une promptitude efficace, inimaginable à notre époque de pesanteur administrative, Doucet convoque Reverdy, attend ses envois, l’éperonne parfois impérieusement. Conseiller du couturier depuis plusieurs années, André Suarès a probablement joué un rôle pivotal, ne serait-ce que pour avoir insisté sur la place des revues littéraires et pour lui avoir conseillé de les collectionner. Or, perplexe devant la confusion qui règne dans l’avant-garde et désireux de rendre visibles les authentiques « efforts parallèles » au sien — en écartant les suiveurs et les indécis — , Reverdy fait part à Doucet fin 1916 de son projet de fonder une revue. Aussitôt redoublement d’intérêt chez Doucet qui va porter une attention parfois critique — la sobriété très concertée de la revue le déçoit — à la fondation de Nord-Sud (1917-1918). À côté des noms d’Apollinaire, de Max Jacob et de Reverdy, vont bientôt s’inscrire à ses sommaires ceux de Breton, Aragon, Soupault, Tzara : difficile d’imaginer une liste de noms plus éclatante s’alignant sous les capitales Nord-Sud, dont Mme Reverdy m’avait indiqué que le beau graphisme avait été conseillé par Juan Gris. Recueillis par Doucet, les manuscrits des poèmes publiés dans Nord-Sud, portant souvent au crayon bleu les indications pour l’imprimeur et tracés de la grande écriture nerveuse du poète, reflètent cette époque fiévreuse : « moment où quelque chose naît » pour reprendre le titre d’un texte composé pour Doucet. Et puis, durant le second semestre de 1918, Doucet, enclin aux réorientations brusques, interrompt son soutien ; il le renouvellera en 1922, ce qui vaudra à la Bibliothèque de posséder une seconde moisson de lettres où Reverdy affirmera avec plus de force sa lucidité intransigeante sur la « foire littéraire ».
Voyez dans ces vitrines quelques-uns des livres qui illustrent comment en 1916, 1917, 1918, Reverdy se fait l’inventeur d’une disposition du poème entièrement nouvelle : une typographie expressive qui traduit dans l’espace la respiration du texte, une nouvelle « syntaxe » comme il le dit en ressourçant le mot à son sens étymologique de disposition, d’assemblage (signalons que, grâce aux éditions Flammarion, le tome I des Œuvres complètes paru en février 2010 offre en annexe des fac-similés des originales, dont la disposition apparaîtra assagie dans les rééditions). Témoignage de la proximité quotidienne qui réunit Reverdy et ses amis artistes : vous avez sous les yeux l’une des trois couvertures toutes différentes qu’Henri Laurens, sculpteur et peintre, a confectionnées pour les exemplaires de tête de Poèmes en prose, trois autres couvertures étant l’œuvre de Juan Gris. Sur un papier kraft, l’artiste a apposé un papier découpé et gouaché figurant une coupe de fruits. La savante simplicité de la composition exhale cette « vie silencieuse » de l’objet (Stillleben, disent les Allemands pour nature morte) dont le cubisme possède le secret. Autre exemple : La Guitare endormie de 1919, recueil de contes et de poèmes illustré par Juan Gris. Sur cet exemplaire de tête sur Hollande, les illustrations de Gris ont été enluminées par le peintre de rehauts gouachés monochromes, qui créent une impression de profondeur dans les entrecroisements d’obliques : une table supportant journal, livre et verre, les arbres de la place Émile Goudeau vus à travers l’encadrement de fenêtre de l’atelier. Est-il surprenant que Doucet, conscient de la qualité unique de cette poésie, ait fait réaliser pour La Lucarne ovale de 1916 cette reliure qui, exécutée par Kieffer sur une maquette de Pierre Legrain, fait ressortir l’or du titre et de la figure de lucarne sur un parchemin vert ?
À partir de 1970, bien d’autres pièces vont s’ajouter au premier ensemble, trop nombreuses pour que je ne puisse qu’évoquer quelques échantillons. Documents inappréciables pour l’étude de l’œuvre des débuts, retouchée par l’auteur vers 1922-1924 : des exemplaires des Ardoises du toit et de La Guitare endormie sur lesquels il a porté au crayon des additions et, moins souvent, des corrections. Nous avons en quelque sorte sous les yeux le travail du poète qui, conduit sans doute par le désir de rendre moins elliptique un texte dont il pouvait douter parfois qu’il fût assez accessible aux contemporains, est également porté par celui de restituer une affectivité plus expansive dans le domaine intérieur, une saveur plus aiguë dans la perception du monde. Autres précieux documents : les liasses constituées pour les recueils de poésie. Elles confirment par leur écriture et souvent leur papier que Grande nature (1925) ou Pierres Blanches (1930) datent de la période créatrice des années 1916-1919. La partie la plus consistante de ces enrichissements est faite de ces « notes », comme Reverdy les appelait avec une exactitude modeste, qui se sont accumulées depuis 1928 pour nourrir, non sans une sélection serrée, les livres de penseur que sont Le Livre de mon bord (1948) et En vrac (1956). Elles sont d’abord inscrites sur de simples cahiers ou carnets ; plus tard, elles seront mises au net sur des bloc-notes. Vous pouvez voir qu’aux lendemains de la guerre, le très désargenté Reverdy affectionne le support banal constitué par ces bandes sous lesquelles les journaux parviennent chaque jour à l’adresse de l’abonné : surfaces oblongues, petites unités matérielles susceptibles de reclassements faciles, qui ne sont pas sans ressemblance symbolique avec les « ardoises du toit » de 1918 sur chacune desquelles « on avait écrit un poème ». À partir de liasses de bandes s’élaborent ces livres où alternent, entre autres tonalités, l’humour parfois sombre du moraliste et le lyrisme grave des réflexions sur la poésie.
Mais on ne saurait donner une idée des livres de Reverdy sans parler — trop brièvement — des grands recueils illustrés où son nom a voisiné avec des artistes qui furent aussi ses amis et souvent ses partenaires dans les discussions et les débats serrés à travers lesquels le cubisme s’est trouvé. Dès ses débuts, il a bénéficié d’illustrateurs exceptionnels, comme les volumes présentés aujourd’hui l’attestent : Braque pour Les Ardoises du toit, Matisse pour Les Jockeys camouflés, Gris pour La Guitare endormie, Derain pour Étoiles peintes, Picasso pour Cravates de chanvre et Sources du vent, Manolo pour Cœur de chêne. Dans sa seconde maturité, il bénéficiera du concours d’éditeurs amis : Tériade, puis les Maeght. Tériade, le premier, a l’idée de tirer parti de son écriture admirablement expressive en lui demandant d’inscrire sur de grands feuillets les poèmes du Chant des morts. Devant la graphie tragique de Reverdy reproduite en lithographie, Picasso est saisi. S’abstenant délibérément des habituels hors-texte, il va apposer de grandes balafres de couleur vermillon qui scandent et accompagnent sans le rompre le flux des poèmes inspirés par le malheur du temps et les drames intérieurs. Émouvante relance d’un projet très ancien (1916) due au fidèle Tériade, Au soleil du plafond fait resurgir en 1955 la collaboration de Gris et de Reverdy autour d’objets aussi familiers que la lampe, la bouteille ou le moulin à café, la gouache de l’un étant accompagnée par un court poème en prose de l’autre. Le tragique se desserre dans La Liberté des mers, que les éditions Maeght achèvent quelques jours avant la mort de Reverdy : les planches en couleurs de Braque avec leurs motifs librement végétaux qu’inspire la vigne vierge de sa maison de la rue du Douanier rythment les pages pour lesquelles Reverdy a choisi une immense écriture appliquée et dans lesquelles Braque va après coup glisser de très simples et expressifs motifs en noir. Au sujet de ces livres disposés sous nos yeux, relisons ce qu’écrit François Chapon dans son savant et sensible Peintre et le livre paru chez Flammarion en 1987 et malheureusement point encore réédité : avec Reverdy, le rapport de l’illustration au texte « se noue sous l’accord plus profond de créations pures à partir d’éléments du réel, les unes au moyen de mots, les autres du dessin. » Et nous voici les mieux placés ici, dans cette Bibliothèque Doucet, pour vérifier que les rapports de l’image au texte « s’établissent avec une pureté particulière qui en fait la beauté ».